
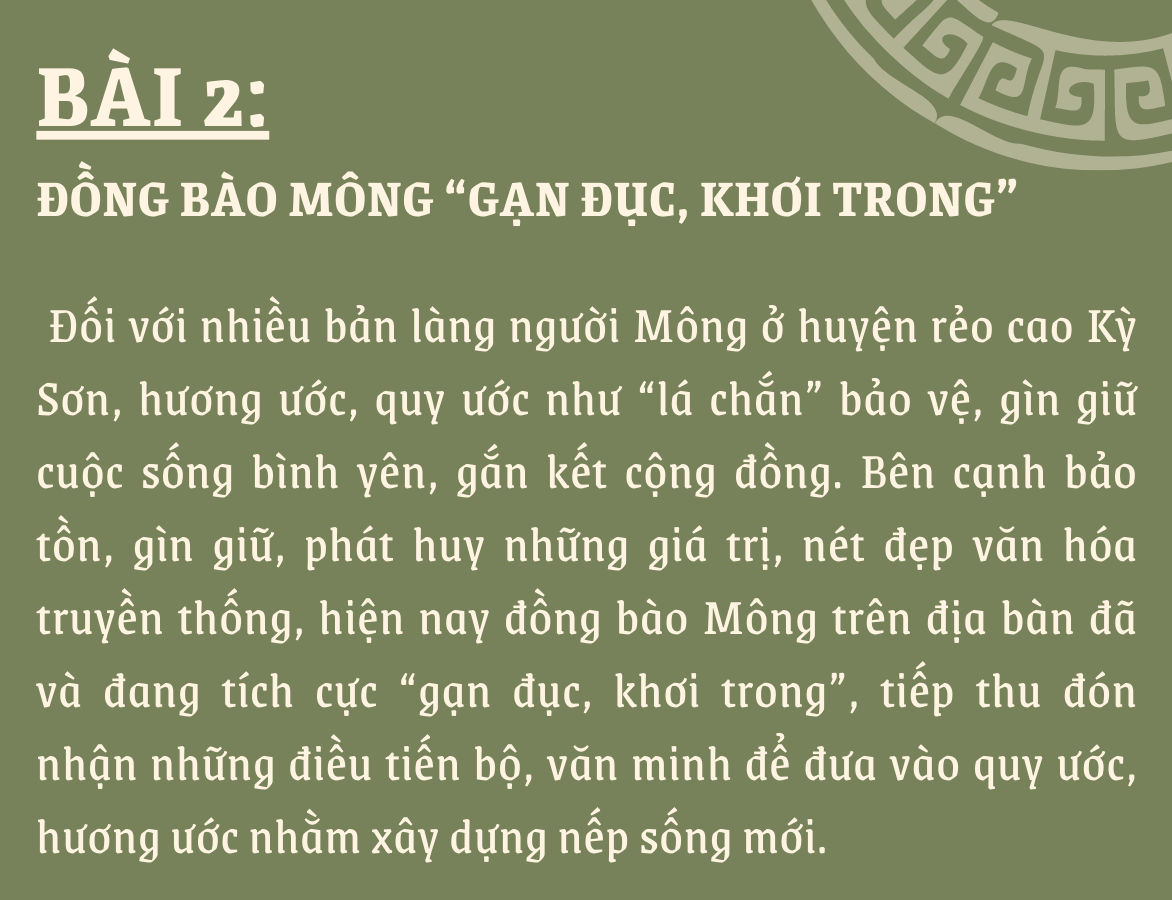

Lors d'une visite au village de Truong Son, dans la commune frontalière de Nam Can, où vivent 305 foyers appartenant à huit grands groupes ethniques Hmong, j'ai interrogé le chef du village, un notable nommé Lau Ga Long, sur les changements intervenus dans la mise en œuvre du nouveau mode de vie culturel, conformément aux coutumes et aux accords villageois. Il m'a répondu franchement : « Cela se manifeste le plus clairement dans les mariages et les funérailles de notre peuple Hmong. » Sur ce, le « grand arbre » du village de Truong Son a donné un exemple : autrefois, si les parents décédaient et que la famille comptait un certain nombre de fils, il fallait abattre autant de vaches, ce qui était très coûteux. Désormais, conformément aux coutumes et aux accords villageois, on est économe et on n'abat qu'une seule vache. Quant aux mariages, l'accord du village stipule clairement : « Pas de dot, pas de gendre vivant avec l'épouse… interdiction d'utiliser des haut-parleurs, des cassettes ou des CD après 22 h et avant 6 h. »

Il en va de même pour la célébration du Têt : il y a quelques années encore, on fêtait deux Têts. « Le Têt anticipé a lieu environ un mois avant le Nouvel An lunaire et dure une dizaine de jours. On y pratique également l’abattage de vaches et de porcs, et on s’amuse. Mais cette période coïncide avec la récolte du riz de fin d’année, ce qui est difficile pour la population. Désormais, les Hmong ne célèbrent plus que le Têt traditionnel », a déclaré avec joie Lau Ba Tu, secrétaire de la cellule du Parti du village de Truong Son.
En réalité, certaines coutumes traditionnelles subsistent chez les Hmong de Ky Son, notamment lors des mariages et des funérailles : le coup de feu est tiré pour annoncer un décès ; le corps n’est pas immédiatement placé dans le cercueil mais laissé sur une civière symbolisant le cheval qui le ramène aux ancêtres ; l’abattage d’un grand nombre de têtes de bétail et de volailles est considéré comme coûteux et source de gaspillage. Il existe également la coutume de laisser le défunt au foyer pendant une longue période (trois jours ou plus). En effet, les Hmong ne tolèrent pas d’inhumer un défunt le même jour (funérailles simultanées) qu’un membre de la famille décédé précédemment ; ils laissent le corps en place pendant une longue période afin d’attendre que leurs enfants, partis travailler ou se marier loin de chez eux, reviennent leur rendre hommage avant l’inhumation. Le lieu de sépulture est choisi par la famille et le clan, car, depuis des temps anciens, de nombreux villages ne possèdent toujours pas de cimetière centralisé ou, s’ils en possèdent un, ne l’entretiennent pas. Enfin, en matière de mariage, les pratiques matrimoniales précoces et incestueuses persistent. Dans certaines régions, les rituels précédant, pendant et suivant le mariage restent lourds et archaïques. C'est pourquoi, dans certains clans villageois, des innovations ont été mises en place pour simplifier les cérémonies de mariage et de funérailles, éliminant progressivement les coutumes désuètes et contribuant ainsi à l'avènement d'un mode de vie plus moderne et ancré dans la culture.

Le clan Tho du village de Huoi Vieng, commune de Dooc May, a établi sa propre convention, définissant les responsabilités de chaque famille. Par exemple, concernant les mariages, la convention Tho prévoit : la suppression de la prosternation en signe de respect des parents et frères et sœurs devant la famille du marié venue annoncer les noces ; l’abolition de certaines pratiques telles que les chants nuptiaux et les tournées de vin après que les maîtres de cérémonie (représentant les deux familles) se soient entendus sur les modalités ; et la cérémonie de baptême du gendre, qui nécessitait auparavant trois gros cochons, qui n’exige plus qu’un seul cochon de 50 kg maximum. Enfin, la convention Tho interdit formellement les mariages précoces, incestueux, forcés et le mariage sans le consentement de l’autre partie.
Concernant les funérailles, la convention du clan Tho stipule l'abolition de la coutume de tirer un coup de feu pour annoncer un décès, ainsi que celle de laisser le défunt au domicile pendant une longue période (trois jours ou plus), car elle est incompatible avec les nouvelles normes culturelles et de vie, et nuit à l'hygiène et à la santé des proches et du clan. La durée des funérailles est réduite à 24 heures maximum. La coutume d'organiser un repas fastueux chez le défunt est également abolie, car, selon l'explication du chef du clan Tho Chong Long : « La tradition veut que plus on sacrifie de bétail et de volaille, plus on témoigne de sa piété filiale au défunt. Or, la plupart des familles sont pauvres, et le coût des funérailles représente toujours un fardeau pour les ménages les plus démunis. » Désormais, un seul bœuf est autorisé par funérailles (même pour les familles aisées). En outre, certaines autres coutumes inappropriées et coûteuses ont également été éliminées, telles que la coutume des morts bénissant leurs descendants, celle d'inviter tous les chefs des départements concernés à s'asseoir ensemble pour accomplir certains rituels pendant 5 à 7 heures, ou encore celle d'interpréter des chants de flûte et de tambour à grande échelle, qui a également été raccourcie, en supprimant les chants inutiles...

Selon M. Tho Ba Re, vice-président du Comité populaire du district de Ky Son, initiateur et chef de file de l'élimination des coutumes archaïques lors des mariages et des funérailles de la famille Tho dans la commune de Huoi Vieng, il a fallu 5 à 6 mois de persuasion persistante, en commençant par le chef de famille et les personnes prestigieuses de la famille, pour obtenir leur consentement à changer certaines choses qui n'étaient plus appropriées. « La difficulté réside dans les liens de parenté qui unissent notre famille à d'autres. De ce fait, de nombreuses procédures liées aux mariages et aux funérailles sont nécessaires et nous souhaitons les simplifier, mais les autres familles peuvent s'y opposer. C'est pourquoi il existe une réglementation stipulant que les coutumes et pratiques familiales doivent être unifiées, respecter une organisation et une mise en œuvre uniformes, et être gérées conformément à la hiérarchie établie par nos ancêtres. Les membres de la famille ont la responsabilité de diffuser le contenu de cette Convention auprès de tous les proches (du côté paternel et maternel) afin qu'ils comprennent clairement la nature du problème et puissent progressivement y adhérer. Les cadres, les membres du parti et les chefs de famille doivent montrer l'exemple en appliquant cette Convention afin de promouvoir un mode de vie culturel, une famille unie et de contribuer à l'édification d'une communauté respectueuse de la culture et de la civilisation, notamment en ce qui concerne les mariages et les funérailles », a déclaré M. Tho Ba Re.
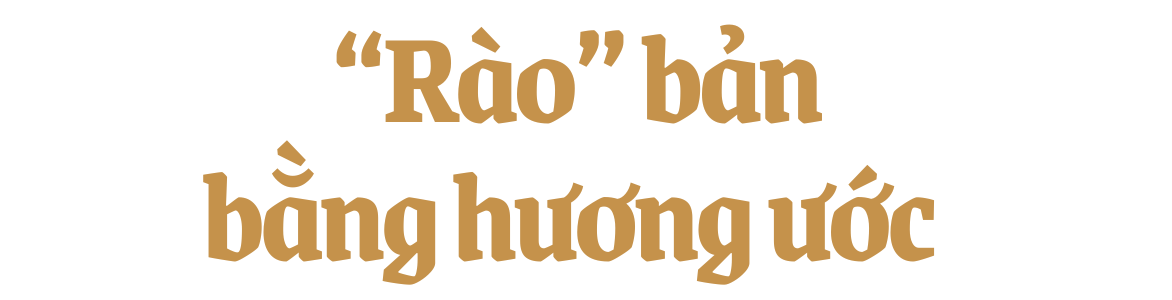
Dans de nombreux villages Hmong des hauts plateaux de Ky Son, les règles et coutumes villageoises contribuent non seulement à enrayer le sous-développement, mais aussi à lutter contre les fléaux sociaux, à résoudre les conflits et les infractions mineures, à gérer et protéger les forêts… offrant ainsi aux habitants une vie meilleure et plus heureuse. Le village de Xam Xum, l'un des plus défavorisés de la commune de Muong Long, en est un exemple frappant. Autrefois considéré comme un haut lieu du trafic et de la consommation de drogue, il plongeait ses habitants dans un cercle vicieux de pauvreté.

Face à cette situation, le Comité populaire de la commune de Muong Long a promulgué une convention villageoise assortie de son propre règlement, comprenant 13 points assortis de règles strictes. Parallèlement, il a enjoint la cellule du Parti, le conseil de gestion et les organisations villageoises, en collaboration avec la police, le comité culturel, le Front de la Patrie et les organisations politiques communales, de mobiliser la population afin d'unir et d'harmoniser l'application de ce règlement. Depuis lors, le village de Xam Xum a commencé à changer : dans chaque maison, les habitants ont affiché des slogans sur la prévention et la lutte contre la drogue, et les mesures sont appliquées avec rigueur. À Mong Phu Kha 1, commune de Na Ngoi, récemment, des personnes crédules, manipulées et incitées par des individus mal intentionnés, ont participé à des activités religieuses illégales, provoquant le ressentiment au sein du clan et perturbant la sécurité du village. S'inspirant du modèle du Peuple Pacifique, le Comité du Parti du district de Ky Son, en coordination avec le Commandement militaire du district, le poste de garde-frontière de Na Ngoi et le Comité du Parti de la commune de Na Ngoi, le village de Pu Kha 1 a également élaboré son propre pacte villageois et son règlement intérieur, comprenant 12 dispositions spécifiques. Ce pacte promeut notamment la solidarité de voisinage, encourage les familles à respecter la loi et le pacte villageois, à ne pas participer aux méfaits sociaux, à ne pas écouter la propagande mensongère, à ne pas suivre d'autres religions et à se conformer uniquement aux croyances et coutumes ancestrales du peuple Hmong. Il est strictement interdit d'introduire d'autres coutumes ou religions, car cela porterait atteinte aux traditions ancestrales de la nation et perturberait l'unité, l'ordre et la sécurité du village.
Selon Vu Ba Tong, secrétaire de la cellule du Parti du village de Phu Kha 1 : le règlement du village, dont les dispositions sont claires, concises et faciles à retenir et à comprendre, est affiché sur la porte de chaque maison afin que chacun puisse s’en souvenir et le respecter. Désormais, les habitants et les familles se sont engagés volontairement à renoncer à toute activité illégale et au prosélytisme, à renouer avec les coutumes traditionnelles, à vénérer leurs ancêtres et à s’unir aux villageois pour construire une vie nouvelle.

De manière générale, les minorités ethniques de Ky Son, et notamment le peuple Hmong, ont depuis longtemps établi des conventions villageoises que tous les membres respectent volontairement. Ceux qui enfreignent ces conventions et conventions sont tenus de s'y conformer, même après avoir été sanctionnés par le village ou le hameau. Les cas de résistance sont rares. Ces conventions et conventions villageoises ont un impact considérable, notamment en matière de protection de la sécurité des frontières nationales, comme en témoignent les dispositions suivantes : l'autorisation de franchir la frontière pour rendre visite à des proches est obligatoire ; les lois des pays voisins doivent être respectées ; l'achat, la vente et l'échange de marchandises prohibées telles que les armes, les stupéfiants et les actes de traite des êtres humains sont interdits ; il est interdit d'héberger des étrangers chez soi ou dans le hameau…
Selon le Dr Hoang Xuan Luong, ancien vice-ministre et vice-président du Comité des affaires ethniques, « le modèle de gestion sociale fondé sur les liens claniques et familiaux, ainsi que sur le prestige des chefs de clan et des anciens du village, témoigne de la capacité du peuple Hmong à gérer et administrer la société. Le système de droit coutumier Hmong est très complet et comporte de nombreux aspects pertinents, notamment en matière de protection des forêts, de ressources en eau, de sécurité et de renforcement des liens villageois. » Par conséquent, savoir démêler le vrai du faux permettra de mettre en place des institutions d'autonomie efficaces et de garantir le respect du droit dans la régulation des relations sociales au sein des communautés résidentielles.
Il est à noter que le district de Ky Son pilote actuellement un projet visant à promouvoir et à faciliter la mise en œuvre de réformes et de simplifications des coutumes et pratiques relatives aux mariages et aux funérailles de l'ethnie Hmong dans le district, et ce jusqu'en 2030, puis les années suivantes dans 75 villages des communes concernées. Ce projet sera ensuite progressivement étendu aux autres communautés ethniques du district.
