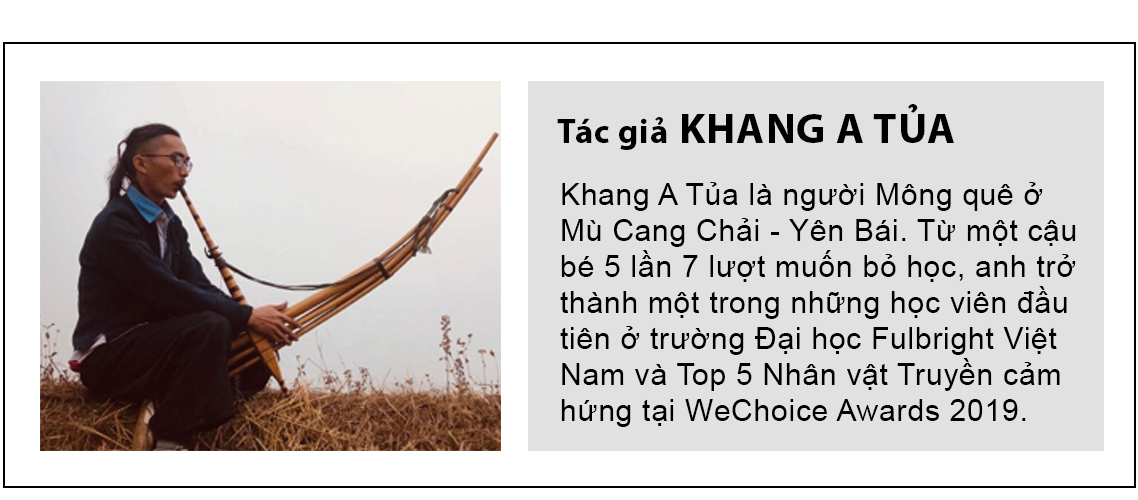Les films mentionnés ci-dessus ont tous été produits à partir d'œuvres littéraires d'auteurs kinh et ont continué d'être produits par les Kinh. De plus, aucune information ne confirme la participation active des Hmong locaux à des consultations culturelles. Par conséquent, les récits et les éléments culturels des minorités ethniques présents dans les récits et les films peuvent différer, dans une plus ou moins grande mesure, de la réalité locale.
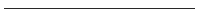
Le film La Femme d'A Phu (1961), adapté de la nouvelle éponyme de l'écrivain To Hoai, raconte les souffrances des petites gens pauvres sous le joug de la domination et de l'oppression féodales et coloniales. Il s'agit du personnage de Mi, qui a dû payer les dettes de ses parents et a été forcée d'épouser A Su, le fils du chef du village Pa Tra ; et A Phu, une orpheline sans famille, un personnage typique de la culture populaire mong. Ces personnages vivent dans la communauté mong, dans les zones géographiques de Hong Ngai, Bac Yen et Son La. Pour analyser et comprendre les détails de ce film, il est nécessaire de s'appuyer sur les images, les pratiques et la compréhension de la culture mong dans le même contexte.
Dans la nouvelle originale « La femme d'un Phu », l'écrivain To Hoai a mal traduit le concept de « ma » (dab) dans la culture Mong et celui-ci a été réutilisé dans la version cinématographique de 1961 sans aucune explication supplémentaire de ce concept.
La scène à la minute 1:10:34 montre le personnage A Su empêchant le personnage Mi de suivre le groupe de migrants français au Laos pour éviter la guerre ; il crie continuellement et serre Mi fort en disant :« Tu es le fantôme de ma famille… Tu es le fantôme de ma famille… Le fantôme de ma famille ne peut mourir que dans ma famille… Ne peut mourir que dans ma famille. »
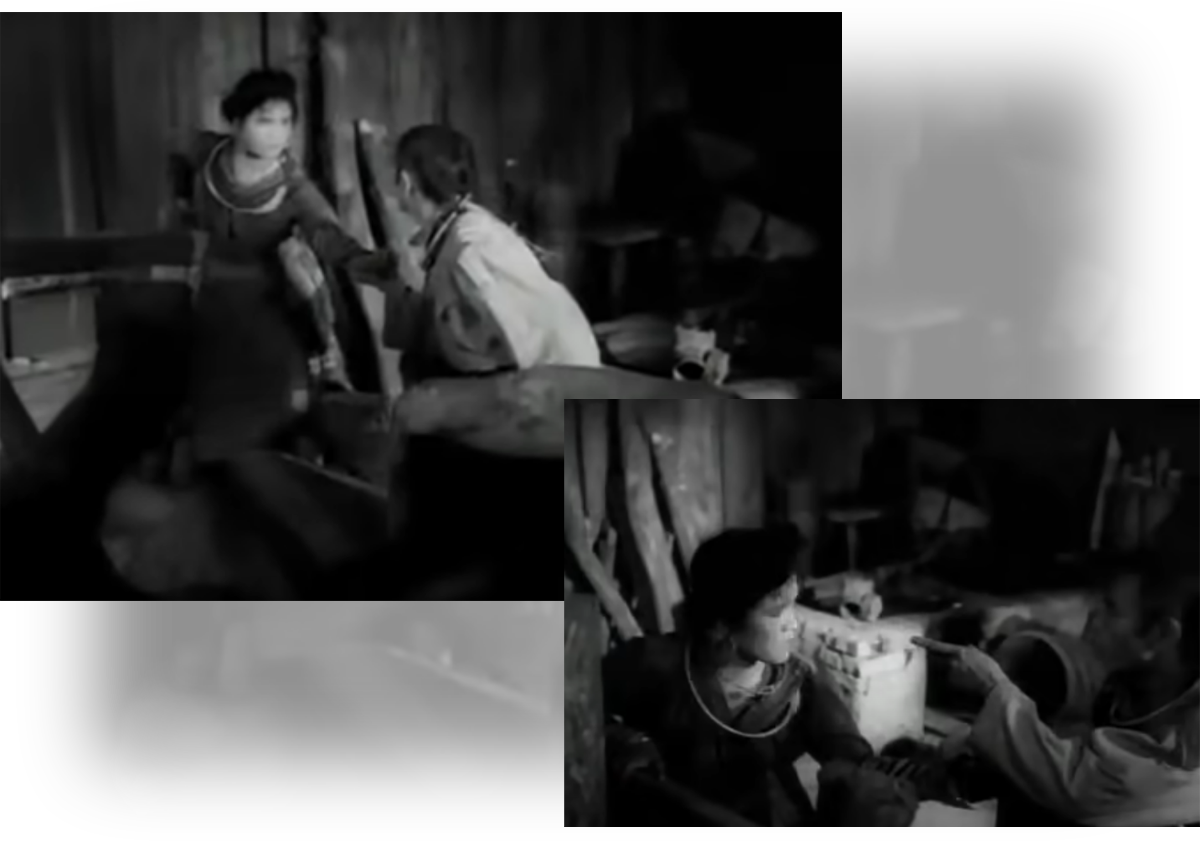
Cette phrase est en fait une expression idiomatique célèbre de la langue Hmong, à l'origine :« ciaj ua koj neeg, tuag ua koj dab ».L’idée générale est que les filles dépendront des hommes dans la société Mong dans leur âme, comme cela sera analysé ci-dessous.
Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre que dans la culture Mong, l'être humain est composé de deux parties : le corps physique (lub cev) et l'âme (ntsuj plig). Selon les croyances traditionnelles, un Mong ne peut absolument pas exister sans l'une de ces deux parties du corps.
Deuxièmement, en langue mông, le mot « dab », souvent traduit en vietnamien par « ma », est en réalité un terme générique désignant des êtres vivants dépourvus de corps physique, notamment : les âmes (ntsuj plig), les dieux (dab qhuas/dab neeb), les fantômes (dab/dab qus), les démons (dab tuag, dab phem) (le mot « dab neeg » en particulier, bien qu'il contienne le mot « dab », a le sens d'un mythe). Selon le contexte d'utilisation, il est nécessaire de comprendre le mot original « dab » différemment en kinh.
Troisièmement, à la naissance d'une personne, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, le corps physique naît en premier. Trois jours plus tard, les Mong organisent une cérémonie d'accueil de l'âme (hu plig), dont les paroles sont similaires à celles utilisées au début du film, lors des funérailles de la vieille mère de Pao, dans L'Histoire de Pao (2006). Elles invitent l'âme (plig) à entrer dans le corps physique. À ce moment-là, l'enfant Mong est intégré au système spirituel (dab qhuas) de la famille du père. Ensuite, s'il s'agit d'une fille, lors du mariage, les Mong font tourner plusieurs fois au-dessus de la tête des mariés une paire de poulets ou une fagot de bois enflammé, juste après avoir ramené la mariée à la maison. Ils se tiennent devant la porte principale avant d'entrer dans la maison du marié pour inviter l'âme (ntsuj plig) de la jeune fille à entrer dans le système spirituel (dab qhuas) de la famille du mari. Désormais, la jeune fille devra vivre avec un corps appartenant à la famille de son mari et une âme appartenant au système spirituel de cette famille. Le fait qu'une belle-fille ou un beau-fils, en rejoignant la famille du mari ou de la femme, en devienne membre pour le restant de ses jours est également présent dans de nombreuses cultures, comme le concept des « trois obédiences » du confucianisme ou la coutume de la « liaison par les cordes » de nombreux groupes ethniques des Hauts Plateaux du Centre.

Par conséquent, lorsqu'on ne comprend pas pleinement les différentes significations du mot « dab », on le traduit souvent facilement par « ma » en langue kinh. Cela entraîne des malentendus, comme celui des Mong qui organisent une cérémonie pour rappeler les fantômes à la vie de leurs parents. Lors de leur mariage, ils deviennent alors les fantômes de la maison de leur mari, comme le montre l'œuvre « Mari et femme A Phu ».
En dehors du contexte du film, mal comprendre le mot « dab » comme étant polysémique dans la langue Mong peut facilement conduire à de nombreuses idées fausses sur la culture Mong que nous rencontrons souvent, comme le fait que les Mong vénèrent les fantômes (ce qui signifie en fait adorer les dieux et les ancêtres, les âmes des ancêtres et des personnes décédées) ; ou le fait que les Mong vénèrent les fantômes (ce qui signifie en fait adorer les dieux ou détruire et faire la paix avec les fantômes).
* Maison
* Leçon 2 : Erreurs de contexte culturel dans les films
* Leçon 3 : Les films déforment les perspectives sur le genre