Leçon 3 : Besoins urgents pour lier la production et la consommation des produits
La chaîne de valeur de la production agricole est une forme de maillage fermé, de la production à l'achat, la transformation et la consommation des produits agricoles. Pour promouvoir ces maillages dans la production agricole, l'État a mis en place des politiques de soutien. Cependant, les besoins actuels des coopératives de Nghe An en matière de soutien sont extrêmement importants et, en réalité, les ressources disponibles ne suffisent pas à y répondre.

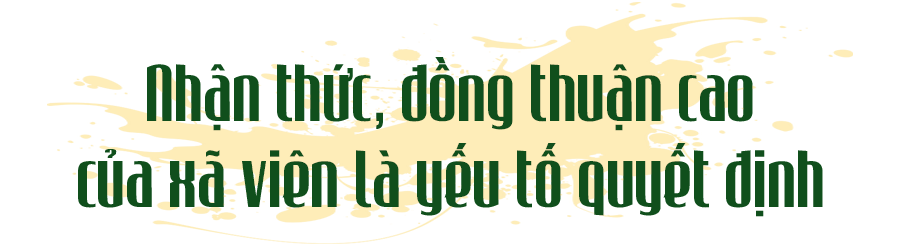
Le XIIIe Congrès national du Parti a déterminé : « Lier étroitement l'agriculture à l'industrie et aux services ; la production à la conservation, la transformation, la consommation, la création de marques et l'augmentation de la valeur des produits agricoles dans les chaînes de valeur » ; l'État a également mis en place des politiques visant à soutenir le développement de la production liée aux chaînes de valeur, en renforçant et en mettant en œuvre de manière synchrone les relations de liaison entre de nombreuses « maisons » : l'État, les agriculteurs, les entreprises, les banques, les scientifiques, les distributeurs… en mettant l'accent sur la promotionpromouvoir le rôle des agriculteurs comme sujet principal.
Selon les statistiques préliminaires, il existe 225 coopérativesNghe AnIl existe des liens dans la consommation des produits agricoles ; de nombreux nouveaux modèles coopératifs sont apparus, reliant la production, la transformation et la consommation des produits, avec des labels et une traçabilité, formant une chaîne de valeur allant de la production à la consommation.

Cependant, les coopératives agricoles de la province sont actuellement confrontées à de nombreuses difficultés. Nombre d'entre elles sont jeunes, la plupart ayant été créées suite à la mise en œuvre du Programme national d'objectifs pour le nouveau développement rural. Leurs capacités limitées, pour assurer efficacement le lien, exigent des coopératives un certain développement, une bonne compréhension de l'étendue du marché, une évaluation des clients et des conseils aux agriculteurs. De plus, chaque coopérative a besoin du consensus de ses membres pour pouvoir mettre en œuvre ses actions.
CoopérativesLes produits agricoles sûrs de la commune de Trung Son (Do Luong) en sont un exemple. Créée fin 2020, la coopérative compte désormais 17 membres. Selon Mme Nguyen Thi Hai, directrice de la coopérative : « Sur le territoire de la coopérative, 8 hectares de terres ont été concédés à la commune pour une durée de 5 ans afin de cultiver des produits agricoles sûrs. » De plus, d’autres ménages membres participent à la production de légumes et de fruits sûrs en utilisant des engrais organiques et des produits biologiques dans leurs jardins et leurs champs. La coopérative fournit des intrants, des produits et des conseils techniques.

En 2023, la coopérative a ouvert de nouveaux magasins pour le commerce, l'approvisionnement en matériel agricole et la consommation de produits agricoles. Cependant, le rôle de la coopérative et de ses membres était extrêmement flou, et le lien avec la consommation des produits restait flou. La participation des membres se limitait principalement à des réductions sur les semences, les engrais et les pesticides achetés au magasin de la coopérative. Les autres coopératives n'avaient pratiquement aucune activité significative, n'avaient pas bénéficié de prêts et ne disposaient pas de plan opérationnel efficace. Les produits étaient petits et fragmentés, de sorte qu'ils n'étaient vendus qu'avec parcimonie au magasin.
Nous avons également contacté et apporté des légumes, des tubercules et des fruits à de grands supermarchés de Vinh et de Hanoï, mais seulement pendant une courte période, puis nous avons arrêté faute de quantités suffisantes. La coopérative a également proposé à la commune de soutenir la certification VietGAP et la production de légumes sains, mais cette proposition n'a pas été concrétisée. Nous souhaitons également fédérer nos membres et créer un espace spécialisé dans la production de légumes sains et de grande valeur, mais pour diverses raisons, nous n'avons pas réussi à les mobiliser pour rejoindre la coopérative », a expliqué Mme Nguyen Thi Hai.

En général, dans le district de Do Luong, faute de terres, de produits disponibles et de concentration, la plupart des coopératives n'ont pas réussi à créer de liens avec la consommation et à répondre aux besoins des clients. M. Ho Quang Hai, directeur de la coopérative de services agricoles de la commune de Lam Son (Do Luong), a déclaré : « La plupart des coopératives… Les terres publiques sont rares, les terres des habitants sont petites et fragmentées, ce qui rend extrêmement difficile la concentration de la production. Nous nous limitons à la fourniture d'intrants, tels que les semences, les engrais et la régulation de l'irrigation. »
L'appareil de gestion de nombreuses coopératives ne répond pas aux exigences de gouvernance ; on observe un manque de dynamisme dans l'association, la coopération et la recherche de ressources externes. Le nombre de coopératives solides a augmenté, mais modestement, atteignant seulement 58,1 %. Le fonctionnement de nombreuses coopératives, notamment agricoles, demeure difficile, et leur productivité et leur efficacité commerciale sont limitées. Les modèles coopératifs liés aux chaînes de valeur sont généralement de petite taille.
______
M. Nguyen Ba Chau - Président de l'Union des coopératives de la province de Nghe An
Il faut reconnaître que la gestion, le fonctionnement, l'organisation de la production et les capacités d'accès au marché des dirigeants de nombreuses coopératives restent obsolètes. Les opérations stagnent et de nombreuses coopératives n'ont pas élaboré de plan d'organisation de la production. La plupart des coopératives agricoles disposent d'installations techniques médiocres et obsolètes, la production manuelle est courante ; l'absence d'usines ou d'entrepôts empêche les produits de répondre aux exigences de la filière ; il n'y a pas de bureaux ; et aucun certificat de droit d'utilisation des terres n'a été délivré.

Parallèlement, les ressources allouées par l'Union provinciale des coopératives pour soutenir les coopératives restent insuffisantes par rapport à la demande. Le financement destiné à la promotion commerciale et à l'harmonisation de l'offre et de la demande pour les coopératives reste limité et difficile à mettre en œuvre. Le rôle de certains responsables, qui suivent de près la localité pour conseiller, soutenir et coordonner la résolution des difficultés des coopératives, est déficient. Les comités du Parti et les autorités de certaines localités n'accordent pas l'attention voulue aux coopératives.
Les raisons susmentionnées expliquent les nombreuses limitations qui pèsent encore sur la consommation des produits des coopératives. Les activités des coopératives en général n'ont guère évolué. La plupart d'entre elles, notamment les coopératives de services agricoles, fournissent principalement des services d'intrants, mais ne consomment pas encore de produits pour leurs membres. Elles n'ont pas encore participé ni démontré leur rôle dans la chaîne d'activités reliant les agriculteurs aux entreprises. En tant que principaux acteurs de la production des produits des coopératives, la prospection commerciale de nombreuses coopératives reste passive, reposant principalement sur leur directeur.
.jpg)
Dans le district de Yen Thanh, on compte 50 coopératives, dont les plus performantes sont celles qui ont su organiser de bonnes relations. Selon M. Nguyen Van Duong, vice-président du Comité populaire du district de Yen Thanh : « Dans le contexte actuel de production fragmentée et à petite échelle, présentant de nombreux risques potentiels, une production non organisée est à l'origine de la situation de « bonnes récoltes et bas prix ». Cette mauvaise organisation a eu des conséquences telles que la stagnation et la difficulté d'écoulement du riz, des légumes, du piment, de la papaye, de la banane, du gingembre et des plants forestiers, comme cela a été le cas ces dernières années dans la province. »
En réalité, les coopératives rencontrent de nombreuses difficultés pour bien s'associer. Les champs sont fragmentés, le nombre de foyers est important, et les agriculteurs hésitent encore à appliquer les nouvelles avancées scientifiques et techniques ; or, pour s'associer, ils doivent produire une seule variété, appliquer un processus de production unifié et obtenir le consensus de tout le village. De plus, les prix des produits agricoles fluctuent constamment en fonction du marché, et les entreprises, par sécurité, fixent souvent les prix dès le départ, ce qui conduit les parties prenantes à rompre facilement les contrats lorsque les prix du marché augmentent, faute de mesures suffisamment fortes pour les encadrer. De nombreuses coopératives manquent de terres, leur fonds de roulement est extrêmement limité et elles n'ont même pas les moyens d'acheter les machines et les équipements de production nécessaires.


Bien que les liens entre la production et la consommation des produits au sein des coopératives présentent encore de nombreuses limites, il faut reconnaître qu'ils ont créé des conditions essentielles pour l'établissement de liens durables et efficaces, contribuant à une meilleure compréhension des liens de production selon les chaînes de valeur associées à la consommation des produits. Ces liens permettront progressivement de surmonter la situation de production spontanée, non conforme aux besoins et exigences du marché, et contribueront à accroître la valeur de la production et à créer une production stable et durable.
En 2018, le gouvernement a publié le décret 98/2018/ND-CP relatif aux politiques visant à encourager le développement de la coopération et de l'association dans la production et la consommation de produits agricoles. Puis, en 2022, le gouvernement a publié les décisions n° 80/2002/QD-TTg et 62/2013/QD-TTg. Ces décisions constituent de véritables leviers pour promouvoir le développement économique de la production agricole en général et de l'association en particulier. Le décret gouvernemental n° 27/2022 est désormais en vigueur.

À Nghe An, en 2018, le Conseil populaire provincial a publié la résolution n° 13/2018/NQ-HDND sur les politiques visant à encourager le développement des coopératives et les liens entre la production et la consommation de produits dans la province de Nghe An. Depuis lors, de nombreux modèles de production efficaces ont émergé, dans lesquels les ménages agricoles se regroupent pour participer à des coopératives et les coopératives s'associent aux entreprises pour former des chaînes de valeur agricoles. Actuellement, dans la province, il existe de nombreuses coopératives de services agricoles qui jouent un rôle important de « sages-femmes », en s'associant aux entreprises pour produire et consommer des produits : les coopératives de Dien Lien et de Dien Phong (Dien Chau) ; les coopératives de Tho Thanh, Minh Thanh et Lien Thanh (Yen Thanh)... Grâce à la mise en place de liens dans la production agricole, la productivité des cultures a augmenté, les agriculteurs réalisent des bénéfices et sont assurés de la production grâce à une production stable.
En réalité, le lien entre agriculteurs, coopératives et entreprises constitue aujourd'hui le modèle de chaîne de production le plus efficace des coopératives. Selon M. Phung Thanh Vinh, directeur du Département de l'agriculture et du développement rural, ce lien a apporté des avantages concrets aux producteurs, aux coopératives et aux entreprises participantes.

Pour assurer une consommation stable de produits agricoles, il est nécessaire d'assurer un volume suffisant, une concentration suffisante, une stabilité, une qualité uniforme, un prix raisonnable et, surtout, de garantir la sécurité alimentaire et les normes d'hygiène requises par le marché. Répondre à ces exigences est très difficile pour chaque ménage agricole, notamment en matière de conservation et de pré-transformation des produits agricoles. Par conséquent, le rôle des coopératives, qui coordonnent la mise en œuvre des différentes étapes, de l'achat des matières premières à la production, en passant par la récolte, la conservation, la transformation et la consommation, est une solution idéale.
Les gens seront soutenus par le capital, la science et la technologie, amélioreront leurs qualifications, créeront des produits de valeur et construiront progressivement des marques de produits, augmentant ainsi la valeur de la production.
______
M. Phung Thanh Vinh - Directeur du Département de l'agriculture et du développement rural
En participant à la chaîne, en agissant comme intermédiaire, la coopérative réduira le coût des services d'intrants et assurera la stabilité des achats de produits agricoles. À Nghe An, de nombreuses chaînes impliquant des coopératives agissant comme intermédiaires ont permis une grande efficacité, notamment les coopératives produisant des légumes, des tubercules et des fruits sains dans les districts de Nam Dan, Quynh Luu et Dien Chau. De nombreuses coopératives achètent, promeuvent et vendent directement leurs produits aux consommateurs.

Par exemple, la coopérative Bac Que Sen (Nam Dan), créée en 2019 avec 7 membres et 22 ménages associés, a connu, après cinq ans d'activité, une expansion continue avec 46 ménages participants. Chaque ménage cultive au moins un hectare de lotus sur une superficie totale de 50 à 60 hectares. La production est diversifiée avec 15 produits, dont 11 répondent aux normes OCOP. La coopérative fournit des semences sous forme de prêts et soutient les processus techniques d'entretien et de récolte des lotus.
Selon M. Pham Kim Tien, directeur de la coopérative Sen Que Bac : « En adhérant à l’association, les membres bénéficient de conditions favorables en matière de services d’intrants, leurs produits sont consommés à des prix raisonnables et préférentiels, et la coopérative les oriente vers les produits populaires sur le marché afin de privilégier et de prioriser la production. Une bonne organisation de l’association améliorera l’efficacité de la production. Chaque membre sera responsable et proactif dans la production familiale, en suivant scrupuleusement les procédés techniques, créant ainsi une source de produits de qualité et concentrée, répondant aux besoins de transformation de la coopérative. »

Conformément à la nouvelle réglementation actuelle de l'État (décret n° 27/2022) : Les projets et modèles soutenant le développement de la production selon la chaîne de valeur dans le cadre du programme cible national pour recevoir un soutien doivent garantir les conditions suivantes : Au moins 50 % des personnes participantes sont les sujets de soutien des programmes cibles nationaux, dans lesquels la priorité est donnée aux ressources pour la mise en œuvre de projets et de modèles avec plus de 70 % des personnes participantes étant des ménages pauvres, des ménages presque pauvres, des ménages nouvellement sortis de la pauvreté, des ménages issus de minorités ethniques, des personnes ayant apporté des contributions révolutionnaires et des femmes issues de ménages pauvres.
______
(À suivre)





