Décès du linguiste, professeur et enseignant du peuple Nguyen Tai Can
Après plusieurs mois de maladie, grâce aux soins dévoués de sa famille et des médecins, le professeur Nguyen Tai Can, enseignant du peuple (GS-NGND), est décédé à son domicile à Moscou à 19h10 (heure de Hanoi) le 25 février 2011 (23 janvier de l'année Tan Mao), à l'âge de 87 ans. Le 28 février 2011, les funérailles du professeur ont eu lieu solennellement à Moscou.
(Baonghean) -Après plusieurs mois de maladie, grâce aux soins dévoués de sa famille et des médecins, le professeur Nguyen Tai Can, enseignant du peuple (GS-NGND), est décédé à son domicile à Moscou à 19h10 (heure de Hanoi) le 25 février 2011 (23 janvier de l'année Tan Mao), à l'âge de 87 ans. Le 28 février 2011, les funérailles du professeur ont eu lieu solennellement à Moscou.
Au domicile privé de Mme Nam Hoa (fille du professeur) à Hanoi, parents et enfants ont installé un autel pour lui rendre hommage.
Étudiants en Littérature (1977-1981) à l'Université des Sciences de Hanoï, ce n'est qu'au début du cinquième semestre sur les neuf que notre classe a eu droit à un cours magistral de M. Nguyen Tai Can. Auparavant, nous nous étions contentés de « respecter et de garder nos distances » avec ce professeur si vénérable que « le confucianisme nous imprégnait jusqu'aux os » (terme employé par le professeur Phan Ngoc). Cet après-midi-là, le professeur de linguistique Dinh Van Duc, responsable de la classe de Littérature, a annoncé : « M. Can vient de rentrer de l'Université de Paris. Lundi matin prochain, il donnera son premier cours magistral. » M. Duc nous a également « révélé » comment optimiser le temps précieux que M. Can passerait en classe.
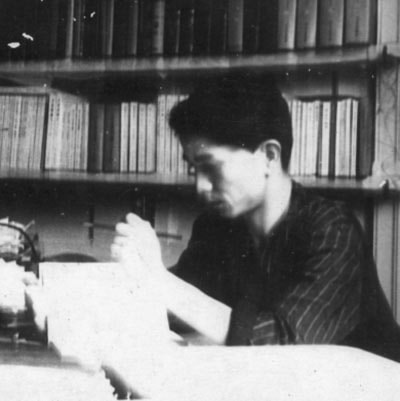
Le linguiste Nguyen Tai Can travaille à
Université d'État de Leningrad (ex-Union soviétique). Internet.
Après quelques minutes de présentation, le professeur déclara : « J'aimerais vous demander la permission de fumer pendant la présentation. » Toujours avec un accent nghe prononcé mais concis, le professeur commença par dire : « Les anciens enseignaient à « apprendre à manger, apprendre à parler, apprendre à emballer, apprendre à ouvrir ». Placer « apprendre à manger » en premier, « apprendre à parler » ensuite, est conforme aux lois naturelles et sociales. Un nouveau-né apprend à téter (une façon de manger), puis à parler ; apprendre à parler relève de la linguistique. Notre peuple, fraîchement sorti de la guerre, doit encore faire la queue toute la journée pour avoir un grain de sel ou une goutte d'huile, mais la pauvreté nous empêche d'apprendre à parler. » En signant la demande d'inscription en linguistique, 31 élèves de la classe se sont portés volontaires pour former des troupes de choc afin de préserver et de développer la langue et l'écriture de la nation.
Depuis l'amphithéâtre, j'ai vu des centaines d'étudiants de différentes disciplines comme la littérature, le Han Nom, l'histoire, la philosophie, le droit, et même des étudiants de l'université des langues étrangères voisine se presser dans le couloir pour écouter le savoir profond de l'« artiste sur la scène ». Plus tard, il n'y eut plus de « respect, mais de distance » entre les professeurs et les étudiants. J'ai appris que ce professeur était né le 2 mai 1926 à Thuong Tho (aujourd'hui commune de Thanh Van, district de Thanh Chuong, province de Nghe An) dans une famille confucéenne de tradition patriotique.
Durant sa jeunesse, il étudia à l'École nationale de Vinh, puis fut transféré à l'École nationale de Huê. Après la Révolution d'Août, il rejoignit la Résistance à Nghe An, adhéra au Parti communiste vietnamien à partir de 1949 et commença également sa carrière d'enseignant. En 1952, il fut nommé assistant universitaire de la première promotion de la zone inter-zone IV. De 1953 à 1954, il dirigea le département professionnel de la zone éducative de la zone inter-zone IV. De 1955 à 1960, le ministère vietnamien de l'Éducation le nomma premier expert linguistique vietnamien en Union soviétique (en poste à l'Université d'État de Leningrad). En 1960, il soutint avec succès sa première thèse de doctorat en linguistique vietnamienne en Union soviétique, sur le thème « Les parties du discours des noms vietnamiens ».
De 1961 à 1971, il a dirigé le département de linguistique de la faculté de philologie de l'université des sciences de Hanoï. En 1980, il a été nommé professeur d'État. En 1982, 1988 et 1990, il a été professeur invité à l'université Paris 7 (France) et en 1991 à l'université Cornell (États-Unis). En 2000, il a reçu le prix d'État Hô Chi Minh pour un ensemble de trois ouvrages : « Grammaire vietnamienne - Mots composés, phrases courtes », « Manuel d'histoire de la phonétique vietnamienne » et « Origine et processus de la lecture sino-vietnamienne ». Avec les professeurs Dao Duy Anh et Hoang Xuan Han, le professeur Nguyen Tai Can est l'un des trois chercheurs en linguistique vietnamiens à avoir reçu le prix Hô Chi Minh. En 2008, il a reçu le titre d'enseignant du peuple.
Sa vie est un brillant exemple d'intellectuel patriote et révolutionnaire, un modèle de travail intellectuel acharné et inlassable. Son parcours de formation a laissé au pays de nombreux talents dans le domaine de la linguistique. Ses travaux scientifiques ont apporté des connaissances scientifiques fondamentales à la société et ont proposé de nombreuses approches aux générations actuelles. Figurant parmi les plus grands experts en linguistique de notre pays, il a formé de nombreuses générations d'étudiants et de doctorants en linguistique, en linguistique vietnamienne et en Han Nom, ainsi que de nombreux professionnels aujourd'hui confirmés. Il a grandement contribué à la création de la filière linguistique à l'Université des Sciences de Hanoï (aujourd'hui Faculté de linguistique de l'Université des Sciences sociales et humaines de l'Université nationale du Vietnam, Hanoï).
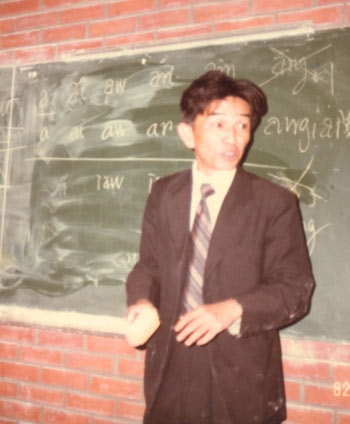
Le professeur Nguyen Tai Can enseigne à l'Université Paris. Photo : Internet
Il prit sa retraite et vécut en Russie, la patrie de sa femme. Durant les dernières années de sa vie, malgré son âge avancé et sa santé déclinante, il parcourut encore des milliers de kilomètres pour visiter sa ville natale, Nghe An. À ces occasions, après avoir brûlé de l'encens pour ses ancêtres, il prenait toujours l'initiative de rester à Vinh pour retrouver amis et collègues et s'amuser, revivant ainsi ses humbles jours. Il s'efforçait notamment de rencontrer des générations d'anciens étudiants en littérature de l'Université des Sciences de Hanoï travaillant dans sa ville natale, afin de les encourager et de les conseiller à contribuer au développement de Nghe An, « une terre où plus on étudie les études locales, plus elle est formidable » (selon ses propres termes). Durant les dix dernières années de sa vie, il envoya régulièrement des articles à des revues scientifiques nationales, notamment la Revue culturelle de Nghe An et la revue spécialisée de l'Université des Sciences sociales et humaines, rattachée à l'actuelle Université nationale du Vietnam à Hanoï.
Concernant sa vie privée, il a épousé Nguyen Thi Kim Loan (de la commune de Hung Tien, district de Hung Nguyen), mais ils se sont séparés par la suite. Sa seconde épouse était une Russe, également linguiste prestigieuse, ayant étudié le vietnamien à de nombreuses reprises. Il y a plus de trente ans, alors qu'il étudiait à la Faculté de Littérature de l'Université de Hanoï, notre génération a entendu de belles anecdotes sur sa relation amoureuse internationale entre le Vietnam et la Russie, entre lui et Mme N.V. Stankyevich.
Début janvier 2006, le Maître rentra de Russie à Hanoï. Le lendemain, l'« érudit Nghe » prit seul le train Hanoï-Vinh pour se rendre au village de Thuong Tho afin d'accomplir son devoir de descendant de la famille Nguyen Tai. Lors de cette visite dans sa ville natale, le Maître m'autorisa à l'accompagner chez lui pour brûler de l'encens et rendre hommage à l'« inspecteur d'académie » Nguyen Tai Dai, qu'il appelait son oncle, décédé plus d'un an auparavant. En brûlant de l'encens et en se rendant sur la tombe de Mme Nguyen Thi Kim Loan, le Maître pleura longuement sur la tombe de son ex-femme, me faisant profondément comprendre le dicton « même si nous sommes séparés, mon cœur souffre encore ».
Par un beau matin, j'ai accompagné mon Maître à Tien Dien (Ha Tinh) pour offrir de l'encens sur la tombe du grand poète Nguyen Du. Bien que je n'aie pas encore lu ses dernières découvertes sur le Dit de Kieu, après une journée passée à l'accompagner, j'ai profondément ressenti les mots « Piété filiale » et « Cœur » chez le vénérable Maître.
Symphonie






