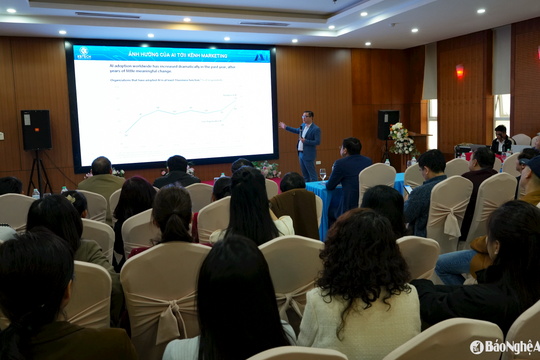L’éducation est-elle la base de la maîtrise de l’intelligence artificielle ?
Depuis l'émergence mondiale de ChatGPT en 2022, l'IA redéfinit le rôle du travail, des compétences et de l'éthique dans tous les domaines. Face aux formidables opportunités et aux défis majeurs, l'éducation est essentielle pour que chacun ne se laisse pas emporter par le tourbillon de l'automatisation, mais, au contraire, sache utiliser l'IA avec sagesse, humanité et responsabilité.
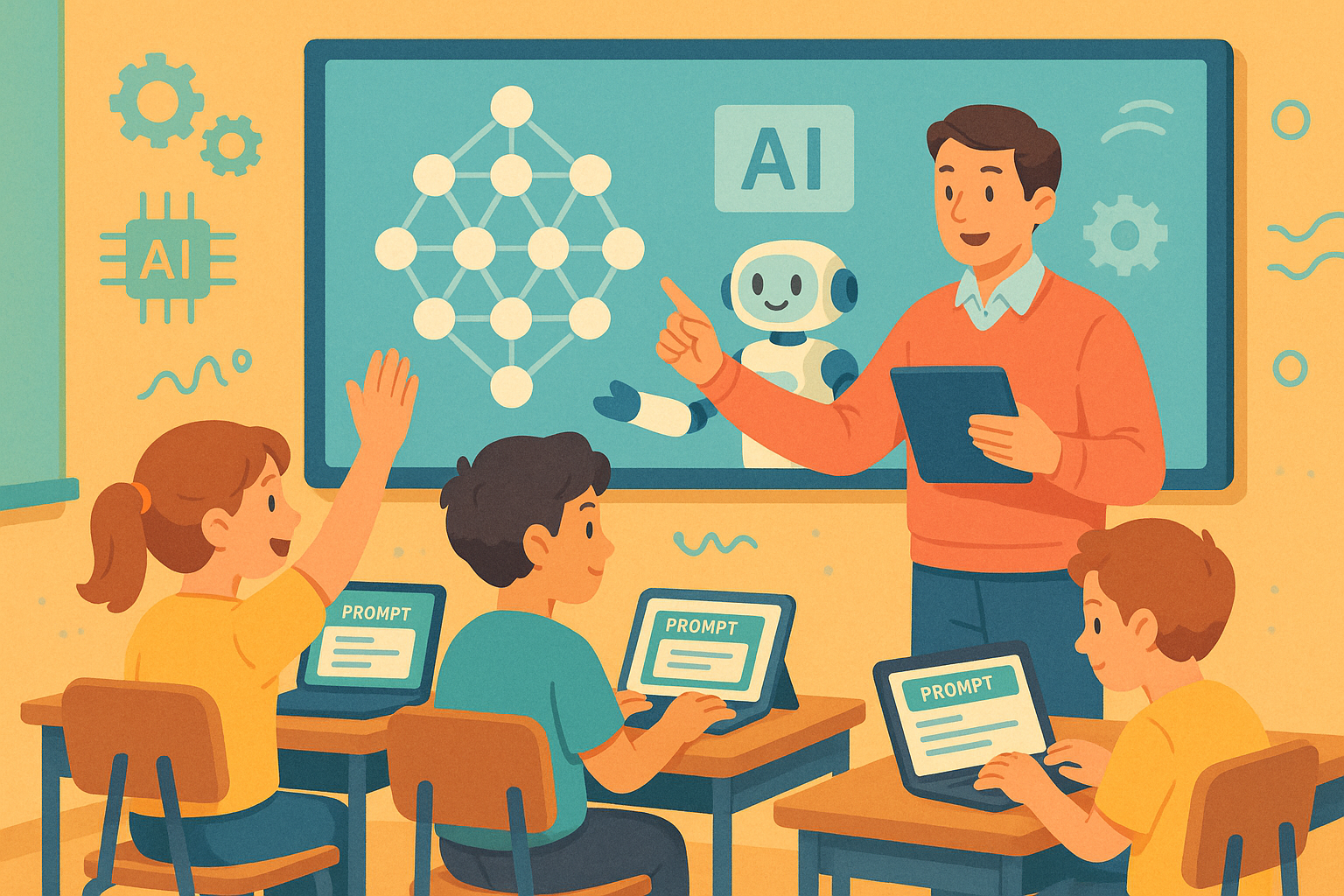
Progrès technologique et réchauffement climatique
En novembre 2022, ChatGPT a été lancé et a atteint 100 millions d'utilisateurs en quelques semaines seulement – un taux de propagation record jamais observé dans l'histoire d'Internet. Fin 2023, selon l'Observatoire des incidents liés à l'IA de l'OCDE, le nombre d'incidents liés à l'IA signalés par la presse internationale avait explosé de 1 278 % par rapport à l'année précédente, coïncidant avec l'explosion des modèles génératifs. De la création de contenu à la programmation, en passant par les soins de santé et l'administration publique, l'IA redéfinit discrètement le rôle de l'humain : les tâches répétitives sont progressivement automatisées, tandis que les compétences de supervision, de créativité et de coordination avec les machines sont de plus en plus requises.
Cette explosion a contraint les organisations internationales à définir d'urgence les « règles du jeu ». Le 7 septembre 2023, l'UNESCO a publié les premières lignes directrices mondiales sur l'IA générative dans l'éducation, arguant clairement que la technologie doit s'inscrire dans un cadre humaniste et respectueux des droits humains, plutôt que de rechercher la performance pure. Moins de six mois plus tard, le 13 mars 2024, le Parlement européen a officiellement adopté l'AI Act, première loi juridiquement contraignante au monde sur l'intelligence artificielle. Cette loi classe l'éducation, la santé et le recrutement comme « à haut risque » et exige que tous les systèmes soient transparents et supervisés par des humains à chaque étape. Ces chronologies montrent que ne pas savoir utiliser l'IA est devenu un nouveau handicap pour affronter la concurrence à l'ère numérique.
Quand la société rencontre l'IA : 3 grands goulots d'étranglement
Malgré son potentiel indéniable, l'IA présente de nombreux défis. Tout d'abord, le manque de compétences et de culture numériques a conduit beaucoup à considérer l'IA comme une « boîte noire magique ». Sans la capacité de poser les bonnes questions ou de vérifier les sources de données, les utilisateurs sont plus susceptibles d'accepter les résultats générés par la machine, ce qui contribue à la propagation des biais.
Deuxièmement, la vaste base de données consommée par l'IA est imprégnée de biais historiques. Sans capacité éthique et juridique, nous risquons d'être confrontés à des violations du droit d'auteur, des atteintes à la vie privée ou une manipulation émotionnelle massive – des risques contre lesquels la loi sur l'IA met en garde.
Enfin, la structure des emplois évolue. L'IA élimine de nombreux rôles répétitifs et crée de nouveaux métiers, comme ceux d'ingénieurs de réponse, de testeurs de modèles et de contrôleurs d'éthique. Le déficit de compétences va se creuser si les systèmes éducatifs ne s'adaptent pas rapidement.
L'éducation est la clé
Le point commun entre ces trois programmes est la nécessité d'une maîtrise universelle de l'IA. L'UNESCO recommande que chaque programme scolaire, du primaire à l'université, enseigne aux apprenants « comment l'IA apprend », la sensibilisation aux droits relatifs aux données et l'utilisation sûre et éthique des outils. L'OCDE a récemment annoncé son intention d'inclure une évaluation « Médias et IA » (MAIL) dans l'enquête PISA 2029 ; cela promet de créer une référence mondiale pour les compétences en IA des élèves de 15 ans.
Dans ce contexte, l'éducation joue un rôle à trois niveaux. Fondamentalement, la mission de l'école est de passer de « l'apprentissage de l'informatique » à « l'apprentissage de la collaboration avec l'IA » : comprendre les mécanismes de l'apprentissage automatique, savoir définir correctement les consignes et savoir évaluer et éditer les résultats.
Au niveau avancé, le programme devrait intégrer des scénarios éthiques réels – des chatbots de rédaction d’essais aux deepfakes – pour aider les apprenants à pratiquer l’analyse et la prise de décision responsable.
Tout au long de la vie, un réseau de cours de courte durée et de micro-certifications aide les travailleurs expérimentés à mettre à jour en permanence leurs compétences, en particulier dans les compétences difficiles à automatiser telles que la créativité, la pensée critique et le leadership d’équipe multiculturelle.
Bien sûr, la réforme des contenus ne suffit pas. Les enseignants doivent être outillés pour devenir des « architectes de l'apprentissage », en exploitant l'IA comme outil pédagogique tout en préservant leur souveraineté pédagogique. Parallèlement, les bases de données d'apprentissage en ligne, qui enregistrent les interactions des étudiants avec l'IA, doivent respecter le principe du « droit à l'explication » énoncé dans la loi sur l'IA, garantissant ainsi transparence et confidentialité.

De la politique à la salle de classe : modèles d'action
Au niveau national, une stratégie de compétences en IA pour 2030 pourrait fixer des objectifs : que 80 % des effectifs suivent une formation de base en IA ; que 100 % des enseignants aient accès à des ressources conformes aux normes de l’UNESCO ; et que tous les établissements de formation disposent d’un programme obligatoire d’éthique de l’IA. Ce cadre comprendrait un cadre juridique pour tester les nouvelles technologies sous supervision, ainsi qu’un fonds d’innovation pour l’éducation en IA afin de soutenir la collaboration entre les écoles et les entreprises sur des solutions.
Au niveau local, les pôles d'apprentissage communautaires en IA fourniront du matériel, des connexions, du mentorat et des programmes de conseil aux startups. Ce modèle est particulièrement utile dans les zones rurales où le risque de « zones blanches numériques » est le plus élevé.
Au niveau de l'entreprise, le modèle de mentorat jumelé, associant un mentor humain à un assistant IA, permet aux employés de raccourcir le cycle de formation. Parallèlement, des laboratoires sandbox permettent de tester l'IA sur des processus réels, mais sous une supervision stricte, transformant ainsi les données internes en ressources partagées pour l'apprentissage.
L'intersection de ces trois niveaux est interdisciplinaire. Lorsque les étudiants en informatique sont amenés à collaborer avec des collègues de droit, de psychologie et de design sur leurs projets de fin d'études, ils apprennent non seulement à écrire des algorithmes, mais aussi à évaluer l'impact social, en tenant compte de l'inclusion et de la durabilité.
L'intelligence artificielle quitte le domaine des « technologies du futur » pour devenir l'infrastructure par défaut de la vie. À mesure que cette infrastructure s'infiltre dans tous les domaines de la société, nos choix se réduisent : prendre l'initiative ou être balayés. L'éducation, qui a pour fonction de transmettre le savoir, de stimuler l'esprit critique et de nourrir les valeurs humaines, constitue le double fondement qui permet aux humains de ne pas se perdre dans le tourbillon de l'automatisation.
Aujourd'hui, l'éducation permet aux individus de comprendre, de questionner et de réguler l'IA. Demain, elle déterminera la qualité des « collègues virtuels » que la société créera : un catalyseur créatif ou une force incontrôlée. Quelle que soit la puissance de l'IA, son exploitation commencera toujours en classe, où nous apprendrons à nous demander « pourquoi » avant de nous demander « comment ».