Istanbul-2 : Quand la diplomatie revient à la réalité
Les premiers contacts directs entre Moscou et Kiev depuis trois ans ont suscité une vive attention internationale. Ce n'est pas nouveau : les événements liés aux négociations sur l'Ukraine, de l'appel du président américain à la visite de l'envoyé spécial américain à Moscou, suscitent souvent des attentes excessives : sinon une fin de crise, du moins un tournant décisif. Or, la réalité est souvent inverse.
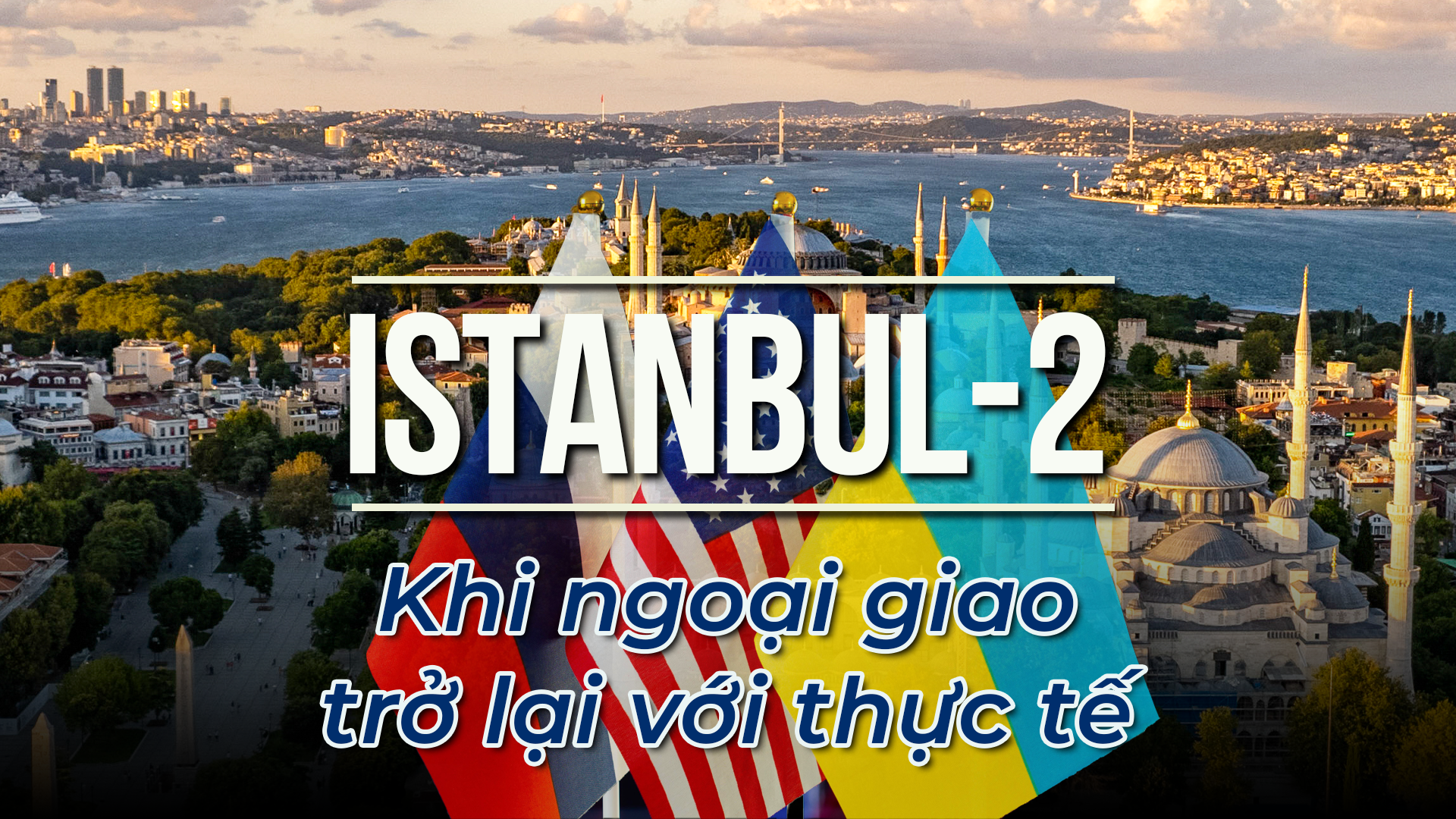
Nhat Lam • 20 mai 2025
Les premiers contacts directs entre Moscou et Kiev depuis trois ans ont suscité une vive attention internationale. Ce n'est pas nouveau : les événements liés aux négociations sur l'Ukraine, de l'appel du président américain à la visite de l'envoyé spécial américain à Moscou, suscitent souvent des attentes excessives : sinon une fin de crise, du moins un tournant décisif. Or, la réalité est souvent inverse.

Bien qu'il n'ait pas permis de percée décisive, Istanbul-2 reste considéré comme une avancée importante dans le processus diplomatique russe. Il convient de noter que, malgré l'opposition de Kiev et de l'Occident, les négociations se sont déroulées dans le cadre proposé par Moscou, ce que de nombreux experts considèrent comme une victoire tactique. Cet événement a également marqué un net passage d'une « diplomatie médiatique » à une « diplomatie pragmatique », reflétant une évolution nécessaire dans un contexte de saturation informationnelle et d'attentes irréalistes.

Trois ans après l'échec d'Istanbul-1, l'approche vis-à-vis de l'Ukraine a quelque peu évolué. Les arguments symboliques, comme l'abandon des frontières de 1991 ou l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, cèdent la place à des considérations plus pratiques, moins idéologiques. Néanmoins, les diplomates ukrainiens et européens continuent de s'appuyer largement sur les médias comme outil de négociation stratégique, surtout en l'absence d'un soutien fort de Washington.
L'objectif de Kiev et de l'Europe est de former un modèle de négociation à long terme, avec des propositions pour un cessez-le-feu renouvelable de 30 jours et un mécanisme complexe de garantie de sécurité, ce qui, du point de vue de la Russie, est irréaliste.
La stratégie consistant à « prolonger la zone grise » semble être un choix compréhensible pour l'Ukraine. En effet, lorsqu'une victoire décisive est impossible, la partie la plus faible a tendance à brouiller les pistes, à accroître son influence médiatique et à attendre des opportunités politiques. Une réaction forte de Moscou, si elle se produit, pourrait devenir un facteur de pression sur Washington – un point clé dans les calculs de Kiev. Ce n'est pas un hasard si les signaux actuels des négociations sont influencés par l'orientation de l'administration Trump et reposent sur la proposition initiale de la Russie à Istanbul.
Istanbul-2 reflète également une réalité inquiétante : la montée d’une « diplomatie postmoderne », où les déclarations de politique étrangère se réduisent à des tweets et où les sommets sont davantage abordés comme des événements sociaux que comme des processus sérieux. La déclaration du président ukrainien selon laquelle il était prêt à rencontrer le dirigeant russe sans préparation particulière, ou l’espoir que M. Trump se présenterait « si le président russe est présent », a transformé le climat des négociations en un état d’irréalisme, de superficialité, plus symbolique que concret.
Parallèlement, le modèle de négociation proposé par Moscou, ignoré à Istanbul-1, est une voie hautement technique et pragmatique : débutant par la rédaction d’un projet par des groupes d’experts, suivi de discussions de haut niveau, et enfin d’une décision au niveau des dirigeants. Il s’agit d’une forme de négociation traditionnelle, privilégiant le fond à la forme, comme en témoigne clairement la composition de la délégation russe : un groupe technique, et non un spectacle politique.

Il est remarquable que la partie ukrainienne, quoique prudemment, ait accepté cette formule. C'est un signe positif, suggérant que le processus pourrait entrer dans une phase plus concrète. Cependant, sa fragilité demeure évidente : toute perturbation, qu'elle soit d'origine médiatique ou due à des divergences tactiques, pourrait conduire à des accusations mutuelles de manque de volonté de négocier. Néanmoins, le signal clair est que l'espace politique autour de la question ukrainienne s'éloigne progressivement de la domination médiatique et des illusions stratégiques pour se rapprocher de la réalité.
Dans ce contexte, les déclarations publiques ou les « fuites de presse » ne semblent plus jouer un rôle décisif. La position de la Russie reste inchangée : la condition préalable à la fin du conflit est le retrait des troupes ukrainiennes des quatre régions annexées par la Russie. Il ne s'agit pas d'une nouvelle exigence, mais d'une réitération de la position annoncée par le président russe mi-2024. Cependant, la balance penchant en faveur de Moscou, tant sur le plan militaire qu'économique, il est tout à fait compréhensible que la Russie maintienne, voire renforce, cette position.


Menaces et négociations âpres deviennent les caractéristiques d'une diplomatie pragmatique qui ne s'appuie plus sur les médias, mais sur l'évaluation des capacités militaires, politiques et économiques spécifiques des parties. Dans ce contexte, la volonté – au moins nominale – de l'Ukraine de négocier selon le modèle technique proposé par la Russie peut être considérée comme un petit pas vers la réalité.
Cependant, cette démarche ne suffit pas à démontrer des intentions stratégiques claires. Le processus de négociation reste fragile et fait face à au moins deux risques majeurs.
Le premier risque réside dans l'exigence d'un cessez-le-feu de 30 jours, que Kiev considère comme une condition préalable à toute avancée dans les négociations. Bien que l'Ukraine ait temporairement mis cette exigence en suspens afin de maintenir le contact avec Moscou, le cessez-le-feu demeure au cœur de sa position officielle. L'Ukraine a reçu le soutien public des pays européens et, dans une certaine mesure, du président Donald Trump, qui a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu immédiat, même si sa position sur les négociations est restée fluide et tactiquement flexible.
Pour l’instant, il n’y a aucun signe clair que Kiev, Washington ou Bruxelles soient prêts à retirer cette condition de l’ordre du jour, ce qui signifie qu’à tout moment, les négociations pourraient échouer alors que les médias reviennent à la vieille histoire : la Russie ne veut pas « arrêter la guerre ».
Pendant ce temps, la position de Moscou sur le cessez-le-feu est restée largement inchangée : elle est prête à accepter une pause à court terme dans les combats, mais rejette fermement un cessez-le-feu à long terme sans garanties solides que l'Ukraine n'utilisera pas ce temps pour se réarmer.
Pour la Russie, la leçon d’Istanbul-1 reste valable : après un « repos », Kiev s’est retirée du dialogue et est revenue sur le champ de bataille avec une force nouvelle.

Le deuxième risque concerne la sécurité de l'Ukraine, difficile à éviter si le processus d'Istanbul-2 vise toujours à démilitariser et à façonner une Ukraine neutre. Si Kiev a des raisons d'exiger des garanties de sécurité, la proposition initiale – le déploiement de forces européennes sur le territoire ukrainien – est inacceptable pour Moscou. Une telle structure soulève non seulement des inquiétudes militaires, mais ouvre également la voie à une influence occidentale indirecte à la table des négociations.
La question est de savoir si les deux parties parviendront à trouver une formule de compromis. Dans le cas contraire, Istanbul-2 échouera comme son prédécesseur. La campagne militaire de l'été sera alors une période de rééquilibrage des forces, et d'ici l'automne, les parties pourront revenir à la table des négociations dans un nouveau contexte. Car, comme l'histoire l'a montré, toutes les guerres se terminent par la paix.

Néanmoins, le cycle de l'histoire semble se répéter : les parties se réunissent à nouveau à Istanbul, comme il y a trois ans. La communauté internationale ne peut qu'espérer que cette fois, l'accumulation des chiffres, des initiatives, des signaux et des échanges suffira à produire un changement qualitatif : un véritable accord de paix, et non une répétition du scénario du report.





